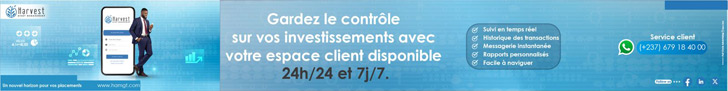Déclarée le 8 mai dans le nord-ouest du pays, la maladie est officiellement endiguée, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans un communiqué publié le 24 juillet. Elle aura tué trente-trois personnes, pour cinquante-quatre cas au total enregistrés.
L’OMS a félicité la République démocratique du Congo (RDC) ainsi que toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués pour mettre fin à l’épidémie. Le bilan final apparaît comme un moindre mal, puisque les autorités congolaises s’étaient préparées avec leurs partenaires « au pire des scénarios » face à une crise « sans précédent » avec cette épidémie qui a touché l’Equateur, à la frontière du Congo-Brazzaville.
L’inquiétude a été à son comble lorsque la maladie, partie de zones isolées dans la forêt équatoriale, a gagné un grand centre urbain, la capitale provinciale Mbandaka et ses 1,2 million d’habitants, reliée directement à Kinshasa et ses quelque dix millions d’habitants par le fleuve Congo.
« A la différence des précédentes épidémies, celle-ci a touché quatre endroits différents, y compris un centre urbain en connexion fluviale avec la capitale et les pays voisins, tout comme des villages isolés dans la forêt équatoriale. Au début, la préoccupation était forte que la maladie puisse se répandre dans d’autres endroits de la RDC et aux pays voisins », a expliqué l’OMS.
Lors de la pire épidémie d’Ebola qui a fait plus de onze mille morts en 2013-2014, en Afrique de l’ouest, l’OMS avait été critiquée pour avoir tardé à réagir. Deux semaines après l’annonce du déclenchement de la nouvelle épidémie, cette agence onusienne et les autorités congolaises ont lancé une vaccination ciblée qui a visé le personnel soignant.
Utilisé pour la première fois, le vaccin contre Ebola, encore expérimental, a été un « outil fantastique » mais il n’a joué qu’un « petit rôle » dans la lutte contre l’épidémie en RDC, a déclaré Michael Ryan, sous-directeur général à l’OMS. De l’avis des autorités congolaises et de l’OMS, l’efficacité de la riposte tient notamment à une réponse humanitaire rapide et agressive, avec un « déploiement extrêmement rapide des équipes nationales et des intervenants internationaux sur le terrain », selon Michael Ryan.
Tout au long de l’épidémie, l’OMS et les ONG ont pris soin de rappeler que la RDC assurait le « leadership » de la réponse pour ne pas froisser la susceptibilité de Kinshasa. En avril, juste avant l’épidémie, les autorités congolaises avaient, en effet, boycotté une conférence humanitaire au bénéfice de la RDC, accusant les Nations unies et les ONG d’exagérer la crise humanitaire dans le pays.
« Cette réponse efficace à la maladie Ebola devrait convaincre le gouvernement congolais et ses partenaires qu’il est possible de contrer d’autres épidémies », a déclaré le directeur général de l’OMS.
Comme dans de nombreux pays africains, le paludisme tue chaque année en RDC des milliers de personnes. Le pays est aussi confronté à une épidémie de choléra qui a touché Kinshasa en début d’année. Vingt-six cas de polio ont également été enregistrés ces derniers mois en RDC, des « dérivés » indésirables du vaccin administré à des millions d’enfants.
Cette épidémie de fièvre d'Ebola est la neuvième sur le sol congolais depuis l’identification du virus en 1976. L’une des plus violentes avait eu lieu en 2007, lorsque la fièvre hémorragique avait particulièrement sévi au Kasaï occidental entre avril et octobre, faisant cent quatre-vingt-sept morts sur deux cent soixante-quatre cas répertoriés.
L’épidémie congolaise est la deuxième flambée d’Ebola depuis la terrible épidémie qui avait frappé l’Afrique de l’Ouest entre décembre 2013 et 2014, causant plus de 11 300 morts sur quelque 29 000 cas recensés, à plus de 99 % en Sierra Leone, au Liberia et en Guinée.