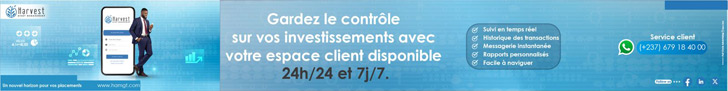L’ambassadeur du Gabon auprès de l’Unesco a présenté à Paris, à l’occasion du colloque des Citoyens du monde et de la première assemblée mondiale organisés du 18 au 20 novembre, le thème « Réflexion sur la citoyenneté en Afrique ».
Des ambassadeurs, des délégués permanents auprès de l’Unesco, des représentants de l’ONU et de la société civile, venus échanger sur les dangers qui menacent l’humanité et déterminés à mettre en place une organisation respectant les personnes, les peuples et les équilibres naturels ont pris part à la rencontre.
La contribution de Rachel Annick Ogoula Akiko a été très saluée car considérée comme une valeur ajoutée à la réflexion globale sur « la citoyenneté mondiale ». L’ambassadeur a fait un rappel historique, politique et socio-culturel de la citoyenneté africaine, telle qu’elle l’entend, « à la fois un statut correspondant à un ensemble de droits définis juridiquement et une identité reposant sur un sentiment d’appartenance à la collectivité », chacun des cinquante-quatre Etats étant doté de son identité.
Sur le plan historique, la citoyenneté était enfermée au sein des groupes ethniques, des clans, des castes et des tribus qui constituaient de véritables sociétés dans lesquelles chaque individu devait respecter les règles de vie de la communauté, en se fondant sur des coutumes et des traditions. Ce qui a contribué « à modeler la citoyenneté africaine telle que nous la construisons et la connaissons aujourd'hui ». L’intégration économique des Etats africains va renforcer ce sentiment d’appartenance à une même communauté.
Trois groupes s’opposaient dans les années 1960, à savoir les « radicaux » du groupe de Casablanca, de Sékou Touré et Kwame Nkrumah, militant pour l’unité politique avant l’intégration économique ; les « modérés » de Monrovia, favorables au respect des frontières issues de la colonisation et partisans d’une unité plutôt progressive dans laquelle l’unité économique devait précéder l’unité économique ; et les « pro-français » du groupe de Brazzaville, composés des anciennes colonies françaises (excepté la Guinée, Madagascar et le Rwanda).
Le défi africain de la citoyenneté
Le défi était de rassembler toutes ces richesses éparses sous une même bannière, en vue « de promouvoir l’indépendance, encourager la pratique de la solidarité entre les Africains et surtout, préserver la bonne entente entre les peuples africains ». C’est de cette cohésion que va naître le panafricanisme, réfléchir dans un cadre continental et faire tomber la Coloniale. Le panafricanisme devenait donc « une relation intrinsèque entre les peuples mais aussi l’affirmation propre à une identité africaine », souligne Rachel Annick Ogoula Akiko.
Pour elle, le sentiment d’appartenance à une même communauté « atteste de la volonté de préserver l’identité africaine qui, par ailleurs, s’était accrue au sortir des indépendances, posant ainsi les préludes de la construction d’un grand Etat citoyen […] Il était question pour les peuples africains affranchis, de s’unir davantage pour panser leurs blessures et penser leur développement ». Cette intégration politico-économique donnera naissance à l’unité africaine, à la construction des grands ensembles économiques ayant comme facteur déterminant l’appartenance à « une même communauté de destin ». Ainsi fut créée, en 1963, l’Organisation de l’unité africaine devenue l’Union africaine (UA) en 2002.
La citoyenneté, une réalité en Afrique
« La citoyenneté est une réalité en Afrique », a rappelé Rachel Annick Ogoula Okiko. Elle invite à « éviter une transposition des réalités occidentales aux réalités africaines », tout en soulignant que « la citoyenneté africaine est en phase de construction, comme l’est encore aujourd'hui la citoyenneté européenne » ; sachant que toute œuvre humaine est indéfiniment perfectible mais fragile. Elle cite la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui laisse à penser que « ce qui semblait acquis peut finalement être remis en cause », constatant qu’à l’instar des citoyennetés occidentales souvent érigées en modèles incontournables, la citoyenneté en Afrique est également en constante évolution.
Les facteurs et recherche de la citoyenneté
Comme facteurs régissant la citoyenneté, Rachel Annick Ogoula Okiko cite le droit à l’éducation, le droit à l’accès aux soins pour tous, la pratique des langues africaines, etc. S’y ajoutent les consultations permanentes des chefs d’Etat et leur impact sur les initiatives nationales. Elle prend l’exemple de la « Journée citoyenne » au Gabon, initiée en 2016 par le président Ali Bongo, qui vise à « responsabiliser les citoyens dans la propreté de leur quartier et d’accompagner les mairies d’arrondissement dans leur tâche d’amélioration de la qualité de vie ».
Elle cite également le Groupe africain de l'Unesco, qui veille à la promotion de sujets d’intérêts communs renforçant le sentiment d’appartenance, avec pour point d’orgue, la célébration de la Semaine africaine. « Ainsi, c’est notre identité qui s’exprime et qui y est valorisée », a-t-elle conclu.
L’intervention de l’ambassadeur Rachel Annick Ogoula Akiko vise à contribuer à l’émergence de la démocratie mondiale, en vue de créer un congrès des peuples.