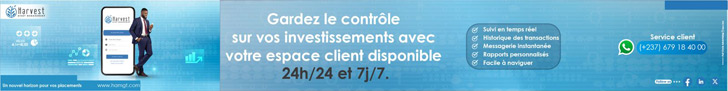Réuni à l'île Maurice, le comité de l'Unesco a inscrit le reggae sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Le regretté chanteur jamaïcain Bob Marley définissait le reggae comme une "raison de vivre". Marginalisée dans les années 1970-1980, la musique jamaïcaine a rejoint quelque 400 traditions culturelles du monde entier. Né à la fin des années 1960 en Jamaïque, le reggae, de Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff... trouve ses racines dans différents styles de musique : le ska jamaïcain, le mento caribéen, les musiques africaines et le rythm'n blues.
Il se fait l’écho du mouvement religieux rastafari qui prône le retour en Éthiopie de tous les descendants d'Africains, déifie l'empereur Haïlé Sélassié et encourage la consommation du chanvre gandia (cannabis).
Mais le reggae se définit avant tout comme une "lutte". "L'une des règles, c'est de se battre", disait Bob Marley. Il est souvent considéré comme la musique des opprimés, qui aborde des questions sociales et politiques comme la prison ou les inégalités.
Cette musique connaît un retentissement international en 1974, lorsque le chanteur britannique Eric Clapton reprend le titre "I shot the Sheriff", du jeune Bob Marley. Ce qui propulsé le chanteur jamaïcain sur le devant de la scène. La même année il sort "No Woman No Cry", où il raconte son enfance dans un ghetto.
Cette mélodie sera classée 37ème meilleure chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone.
C'est l'artiste ivoirien Alpha Blondy qui se fait le porte-étendard du reggae en Amérique, grâce à son album "Jah Glory", sorti en 1982.
Plus de 37 ans après la mort de Bob Marley, le reggae s'est inscrit à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco, afin qu'il contribue à la prise de conscience internationale "sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité".