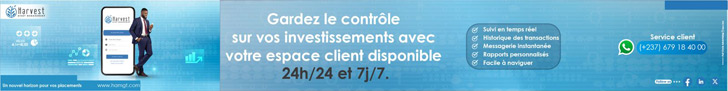Le programme approuvé le 25 février à Niamey, au Niger, par les chefs d’Etat de la région, couvre la période 2019-2030, pour une valeur de quatre cents milliards de dollars, dont un programme prioritaire, selon un communiqué final.
Le texte relève que le programme prioritaire, qui doit « catalyser les investissements climat », concerne « la période 2020-2025 » et « les chefs d’Etat ont décidé de sa mise en œuvre immédiate ». Les Etats doivent contribuer « à hauteur de 10% au financement du programme ».
Le sommet a décidé de la création d’un secrétariat permanent basé à Niamey en vue de « coordonner » les projets retenus et censés atténuer les effets du réchauffement climatique au Sahel.
La réunion visait essentiellement à valider le « plan d’investissement climatique » pour « la période 2018-2030 », qui concerne dix-sept Etats de la bande sahélienne, allant de l’Atlantique à la Corne de l’Afrique.
Le plan dont le coût est estimé à quatre cents milliards de dollars (trois cent cinquante milliards d’euros) est « la traduction des engagements de nos Etats à travers l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique », selon le ministre nigérien de l’Environnement, Almoustapha Garba. Il comprend « un programme prioritaire » axé sur six projets visant diverses actions sur le terrain pour « limiter » les émissions de gaz à effet de serre et pour permettre à la population « de s’adapter aux changements climatiques ».
« Nous continuons à payer les conséquences d’une situation dont nous sommes loin d’être responsables », s’est plaint le président nigérien, Mahamadou Issoufou. Pour financer « des actions d’atténuation » du réchauffement, le programme d’urgence évalué à 1,3 milliard de dollars sera soumis dès ce mardi aux partenaires extérieurs du Sahel à Niamey.
Parmi les « conséquences » redoutées des effets climatiques, Mahamadou Issoufou a cité les modifications de la pluviométrie, les sécheresses récurrentes, l’avancée du désert, la raréfaction de l’eau, des pâturages et l’accentuation de la pauvreté.
Mahamadou Issoufou a établi un « lien » entre le climat et l’insécurité. « La naissance et le développement de Boko Haram sont en partie liés à la paupérisation de la population du fait du retrait (des eaux) du lac Tchad qui a eu un impact sur les ressources agricoles, pastorales et halieutiques ». Et « le Sahel sera probablement une des principales régions d’origine des deux cent cinquante millions de migrants attendus en 2050 dans le monde ».
Le Sahel, qui abrite plus de cinq cents millions d’habitants - pour une superficie de 10 millions de km2 - est extrêmement vulnérable face aux changements climatiques, « ce qui fragilise à la fois les conditions de vie de la population et les écosystèmes », selon un document publié au sommet.
Outre le président du Niger, quatre chefs d’Etat - Idriss Déby Itno (Tchad), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Alpha Condé (Guinée) et Denis Sassou NGuesso (Congo)- ont assisté à cette première conférence pour le Sahel.
En marge du sommet, le ministre français de la Transition écologique, François de Rugy, va lancer près de Niamey des travaux d’une centrale électrique pour un montant total de 18,7 milliards de francs CFA (28,5 millions d’euros) cofinancés par l’Agence française de développement.
L’Afrique subsaharienne connaît une importante dégradation. L’érosion côtière « est de plus en plus accentuée » avec « un à deux mètres par an au Sénégal et à Djibouti » et « vingt à trente mètres par an dans le golfe de Guinée », selon le même document.
Les dix-sept Etats du Sahel sont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée Conakry, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad.
Outre la pauvreté et les effets du changement climatique, près de la moitié de ces pays est confrontée à des activités djihadistes.